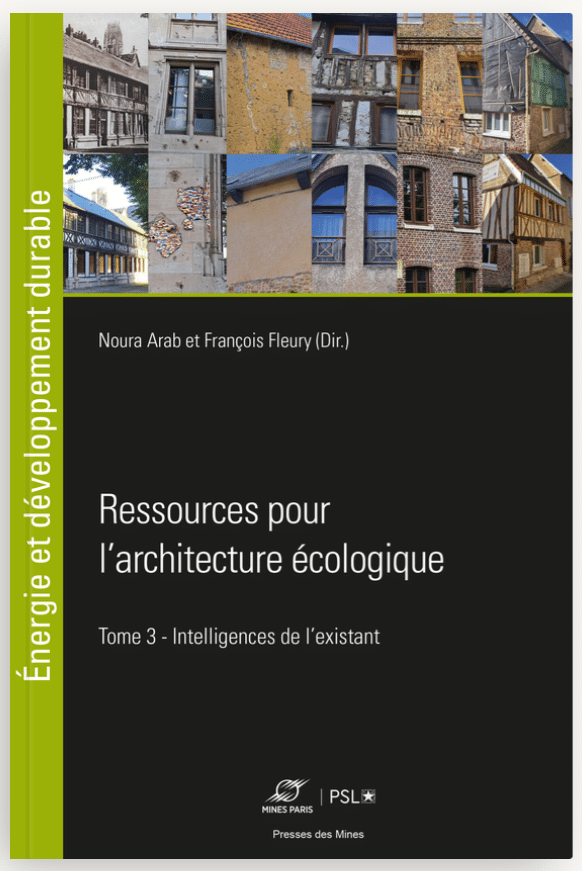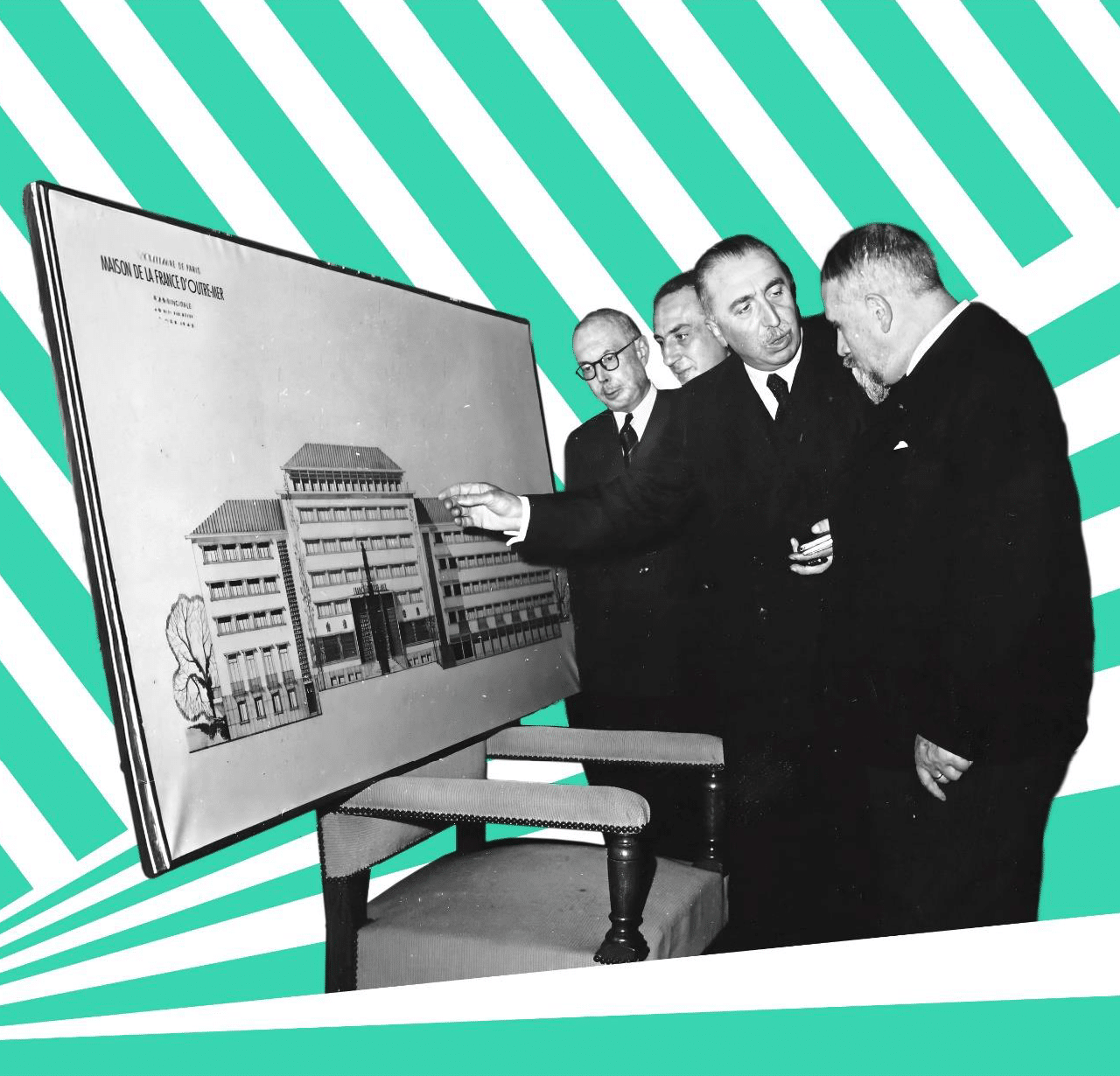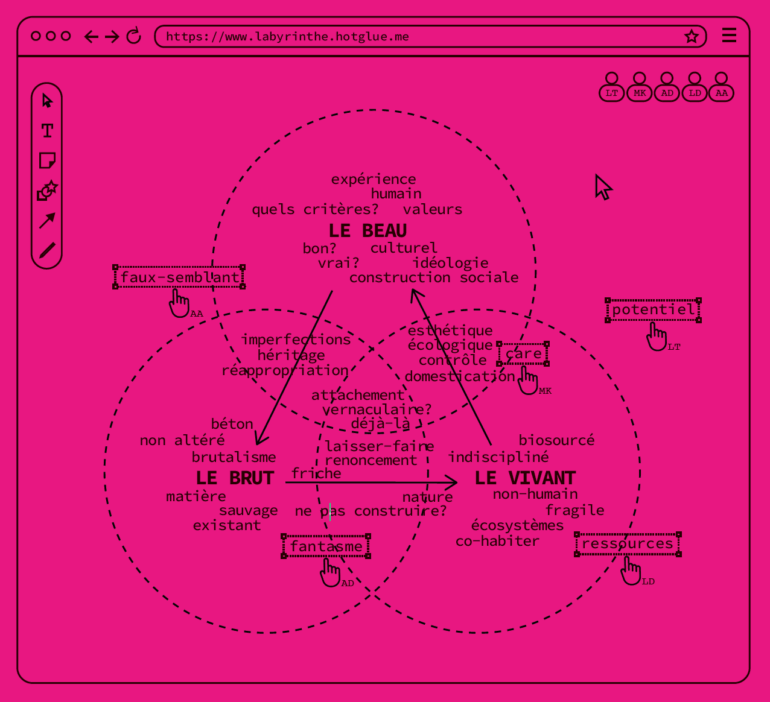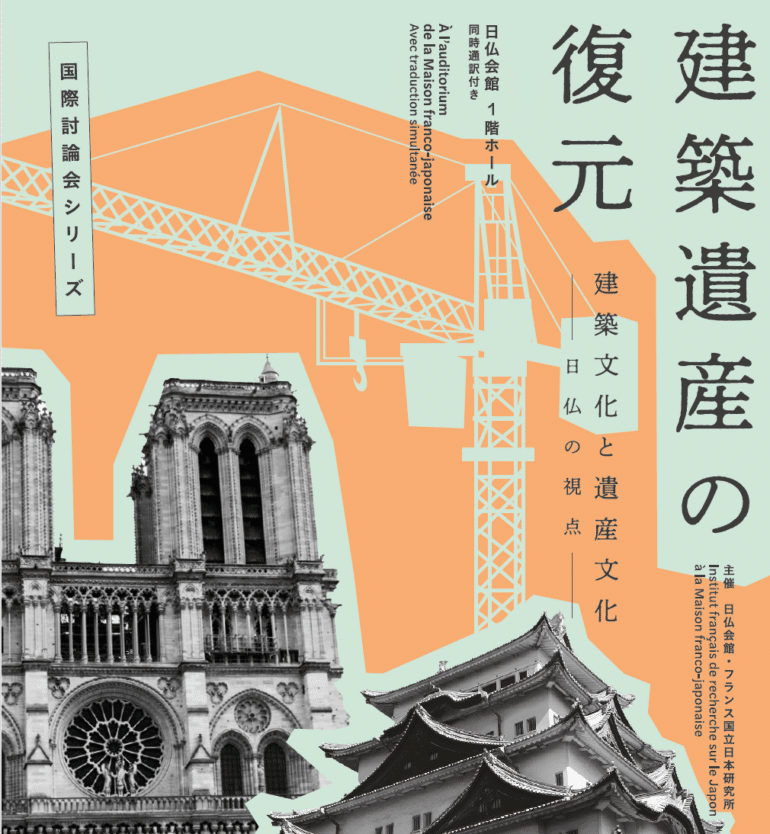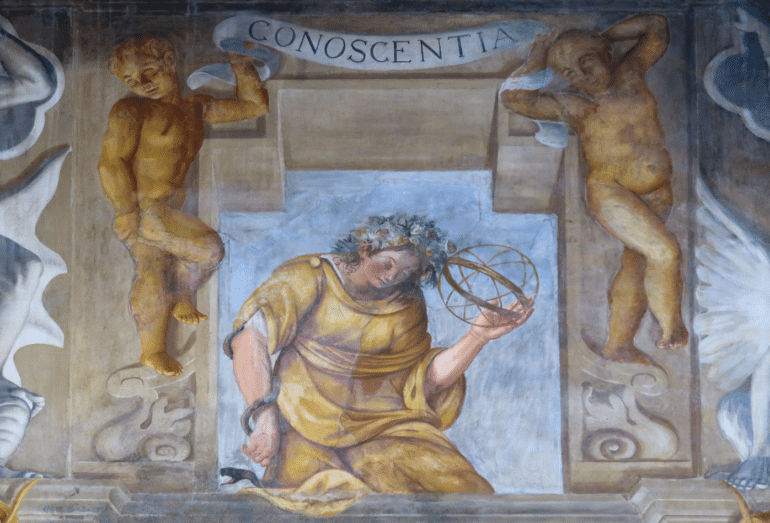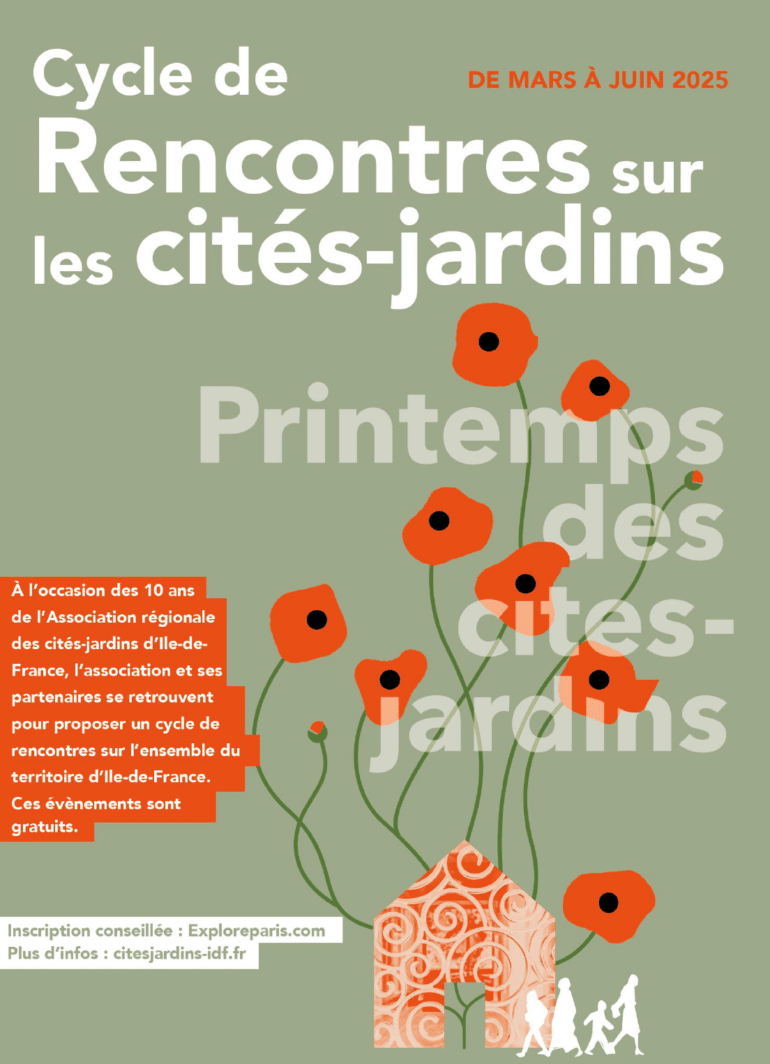Jusqu’au 25 juin 2025 –
Le laboratoire ATE lance un appel à communication pour une journée d’études Habiter le littoral en mouvement : formes, pratiques, représentations qui se tiendra à l’ENSA Normandie les 25 et 26 novembre 2025.
L’objectif de cette journée d’études est de questionner les impacts du changement climatique sur les formes bâties, l’évolution des occupations des sols et des modes de vie du littoral depuis les années 1970 – de fin de croissance et de montée de préoccupations écologiques – en croisant les apports des différents champs disciplinaires, scientifiques (écologie, géographie, histoire, sociologie) et opérationnels (architecture, urbanisme, paysage), aussi bien dans leurs dimensions théoriques qu’appliquées.
L’appel à communication est ouvert jusqu’au 25 juin 2025.
Les propositions de communication se font au moyen d’un résumé. Le résumé comprendra l’évocation le titre, les noms des auteurs et leurs affiliations institutionnelles, la problématique, le corpus, les méthodes et les principaux résultats.
La journée d’études est organisée par Valter Balducci et Milena Guest, chercheurs au laboratoire ATE.
L’appel à communication est disponible ICI
visuel : Littoral de Granville, photo prise le 23 février 2024 © Valter Balducci, 2024