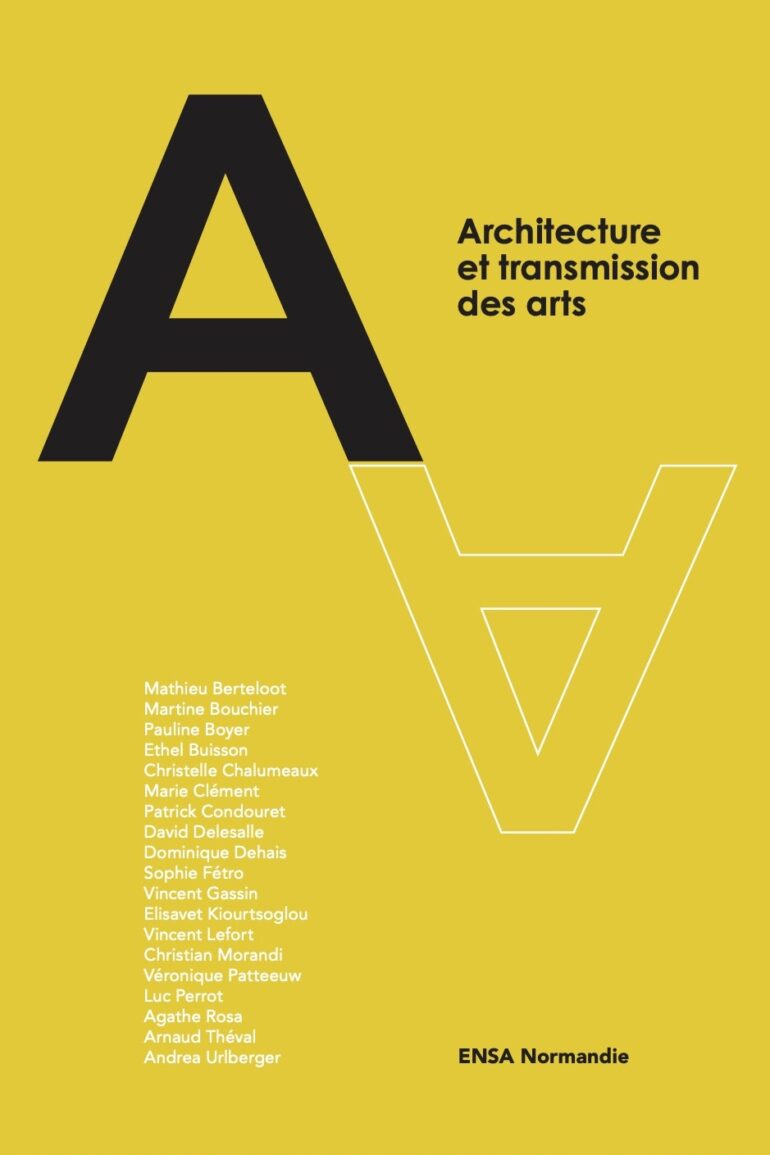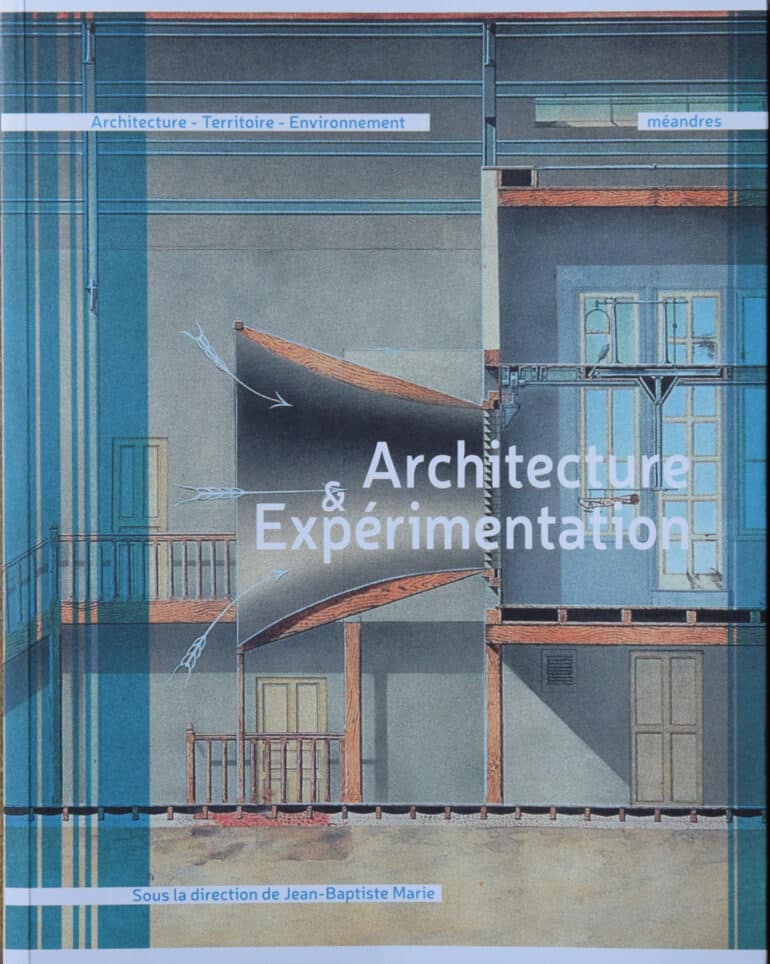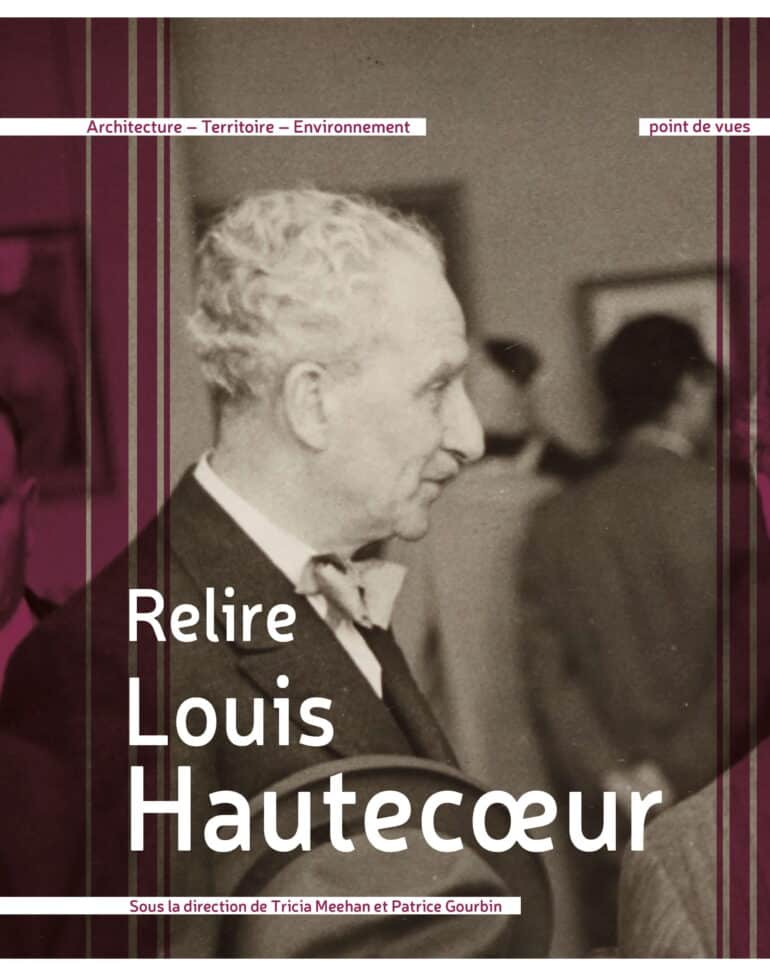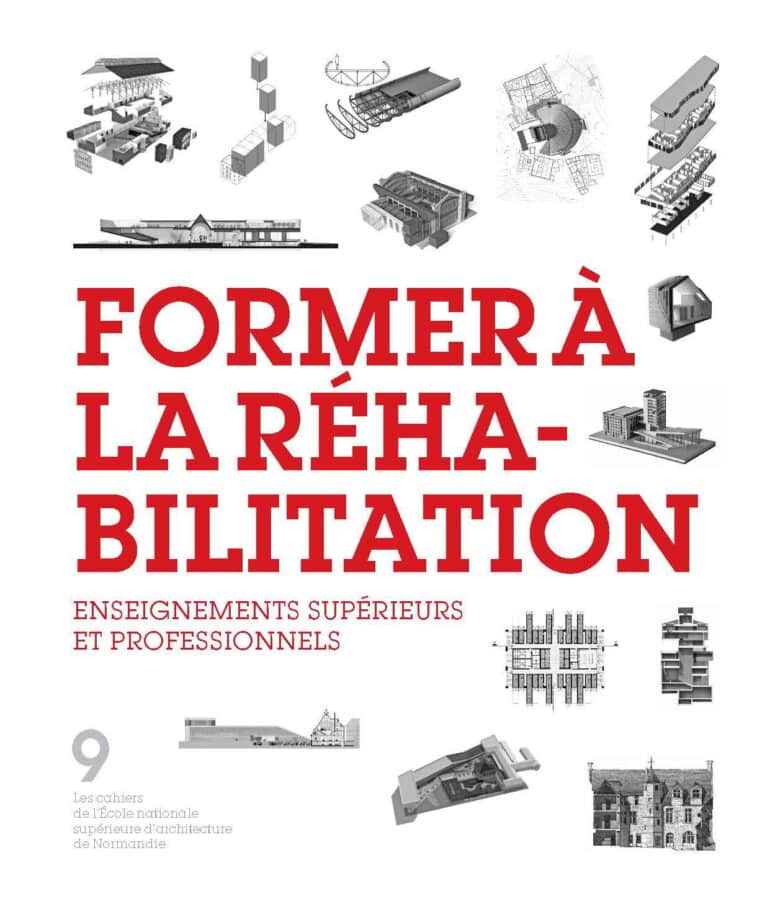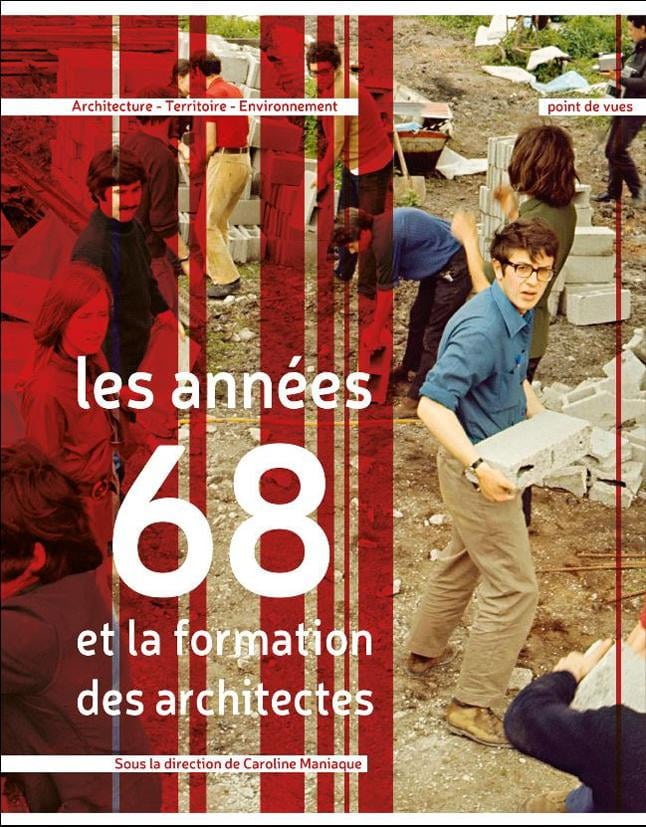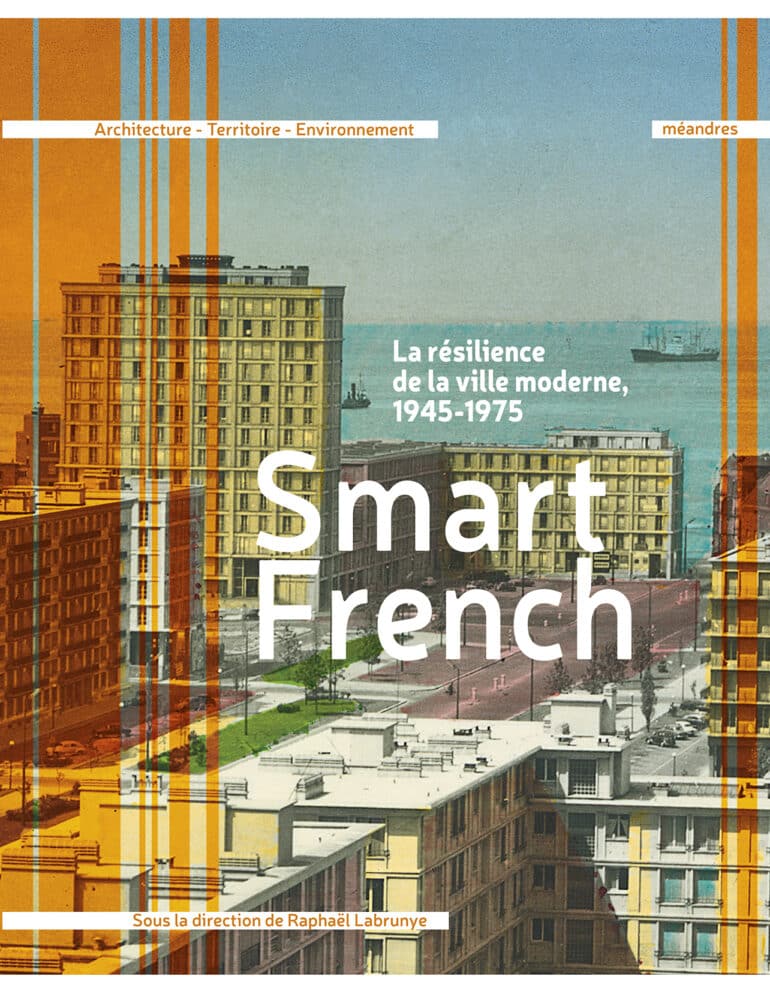
Les éditions des méandres et le laboratoire ATE font paraître l’ouvrage Smart French. La résilience de la ville moderne. 1945-1975.
Cet ouvrage collectif est publié sous la direction de Raphaël Labrunye, chercheur au laboratoire ATE.
Résumé de l’ouvrage
Le projet de recherche Smart French part du postulat que les ensembles de logements construits en France entre 1945 et 1975 possèdent des qualités architecturales sous- estimées, propices à la transition environnementale. Il offre une alternative aux approches globalisantes, souvent dépréciatives, et aux études monographiques, nécessaires mais peu généralisables. Face à l’absence de données statistiques sur cette architecture, l’étude s’attache à élaborer des indicateurs pertinents, à partir d’un corpus de près de 300 opérations, pour exposer des critères comme les caractéristiques bioclimatiques, l’éclairage naturel ou la ventilation.
L’analyse repose sur des données issues des revues architecturales contemporaines de ces ensembles et des discours des concepteurs. Grâce à des méthodes statistiques, l’objectif est d’identifier des récurrences architecturales, afin de nourrir des politiques publiques d’intervention ciblées sur ces ensembles, qui prennent en compte leurs spécificités architecturales et environnementales.
Auteurs et autrices
Shahram Abadie
Gauthier Bolle
Karim El Alami
Margherita Ferrucci
Élise Guillerm
Amir Mahamoud Issa
Raphaël Labrunye
Ignacio Requena
Daniel Siret
Yannick Sutter
La publication de cet ouvrage a été possible grâce au concours du Ministère de la Culture, du PUCA, de la Région Normandie, du laboratoire ATE (ENSA Normandie), du laboratoire Arts, civilisation et histoire de l’Europe – Arche – UMR 3400 (ENSA Strasbourg), de l’ENSA Clermont-Ferrant et de l’ENSA Bretagne.
Plus d’informations sur l’ouvrage ICI
visuel : couverture de l’ouvrage Smart French, éditions des méandres, 2024
Publication :