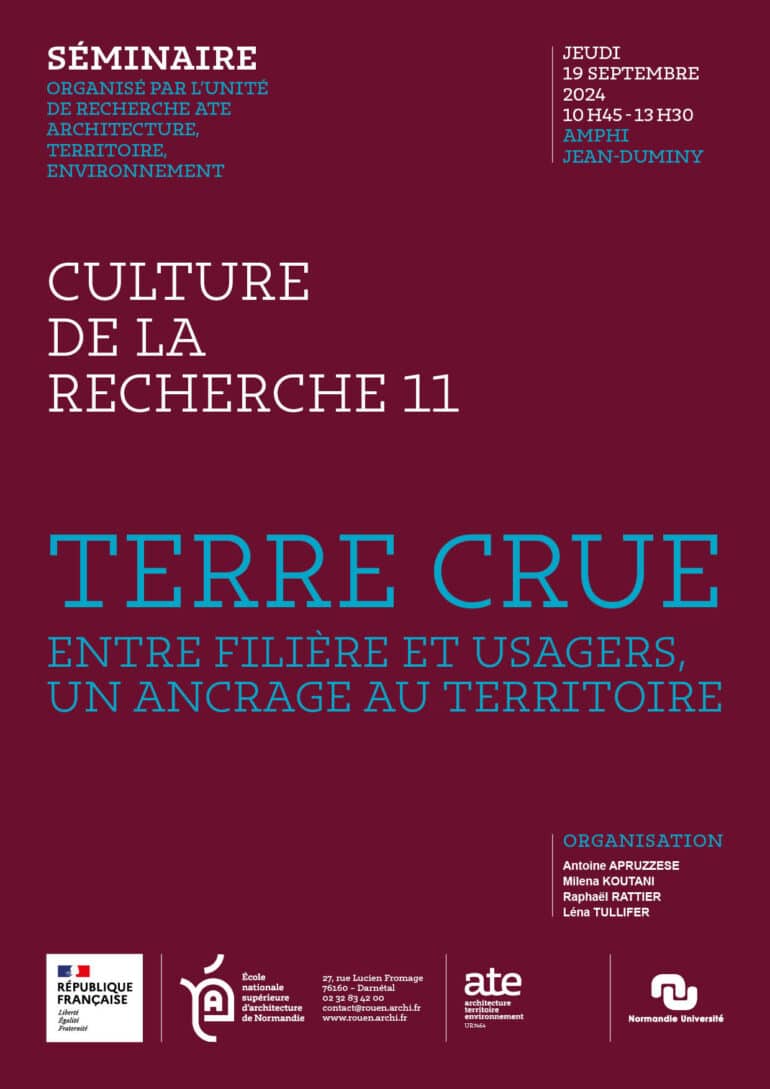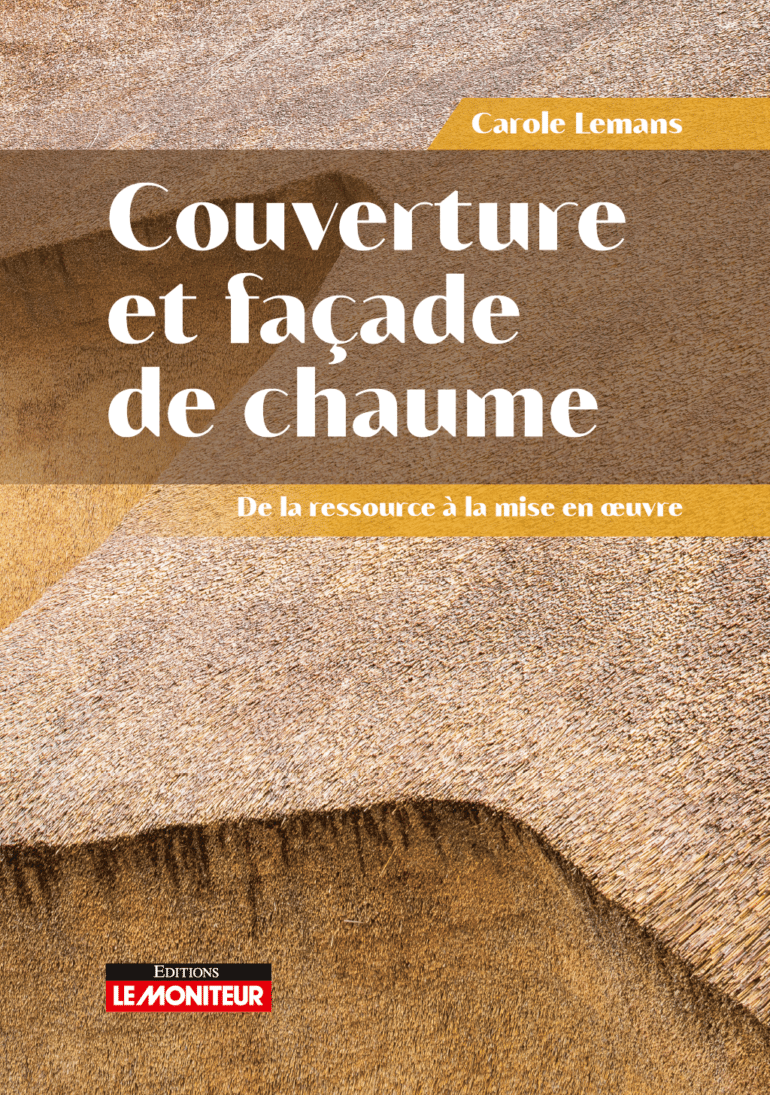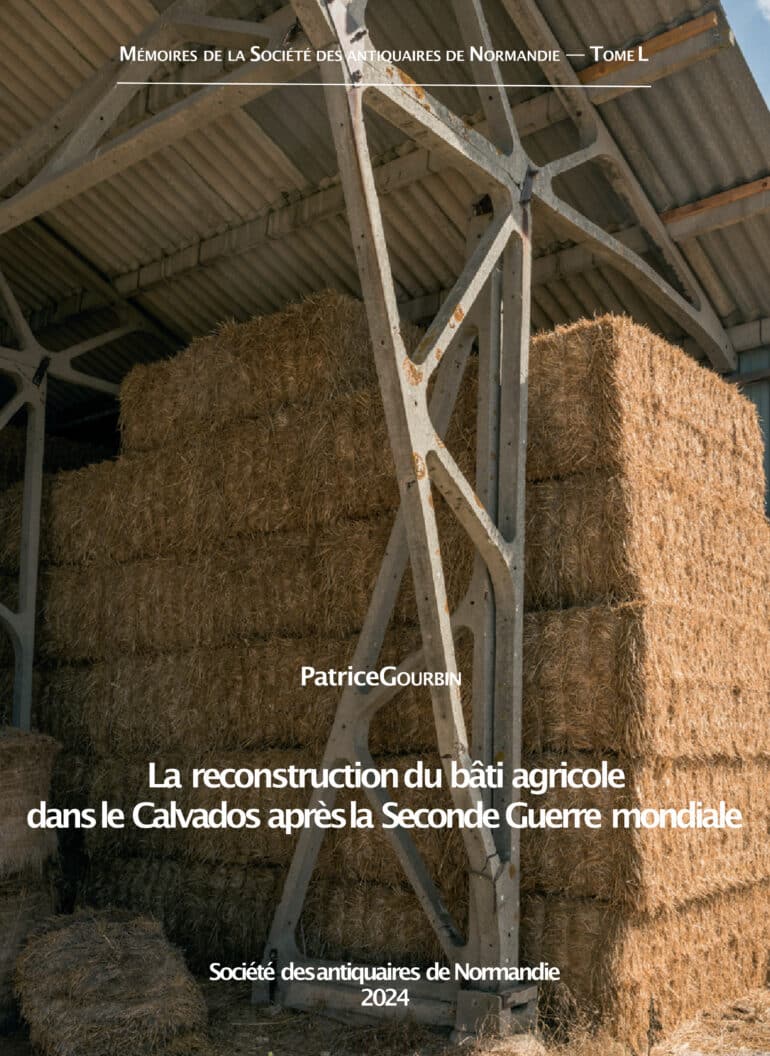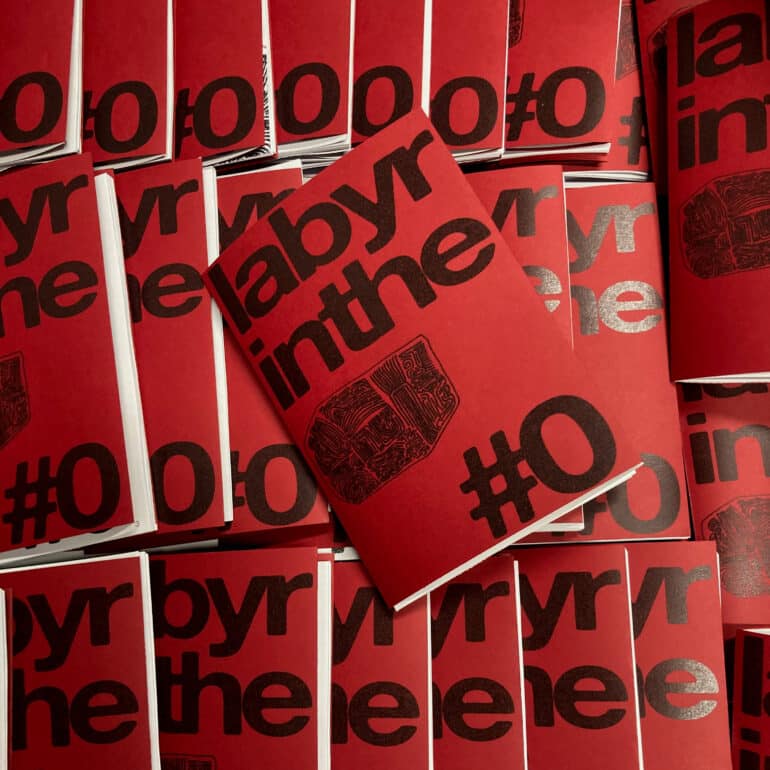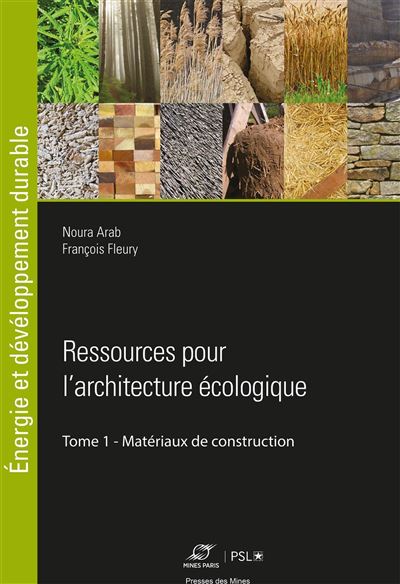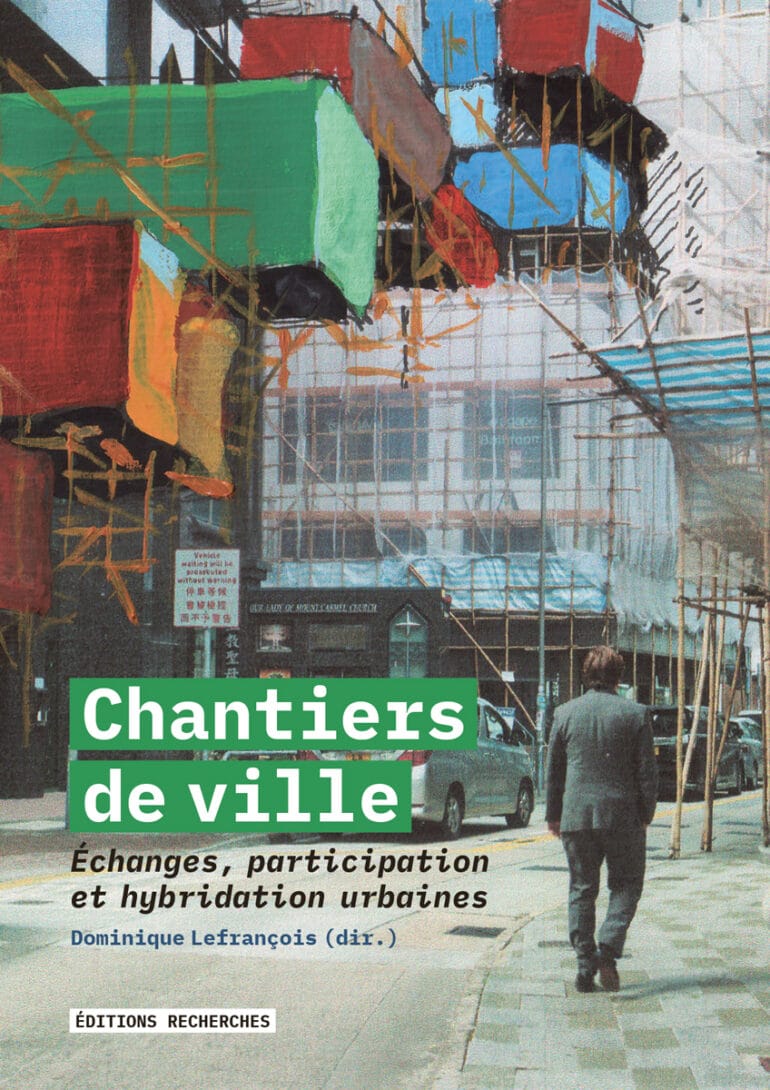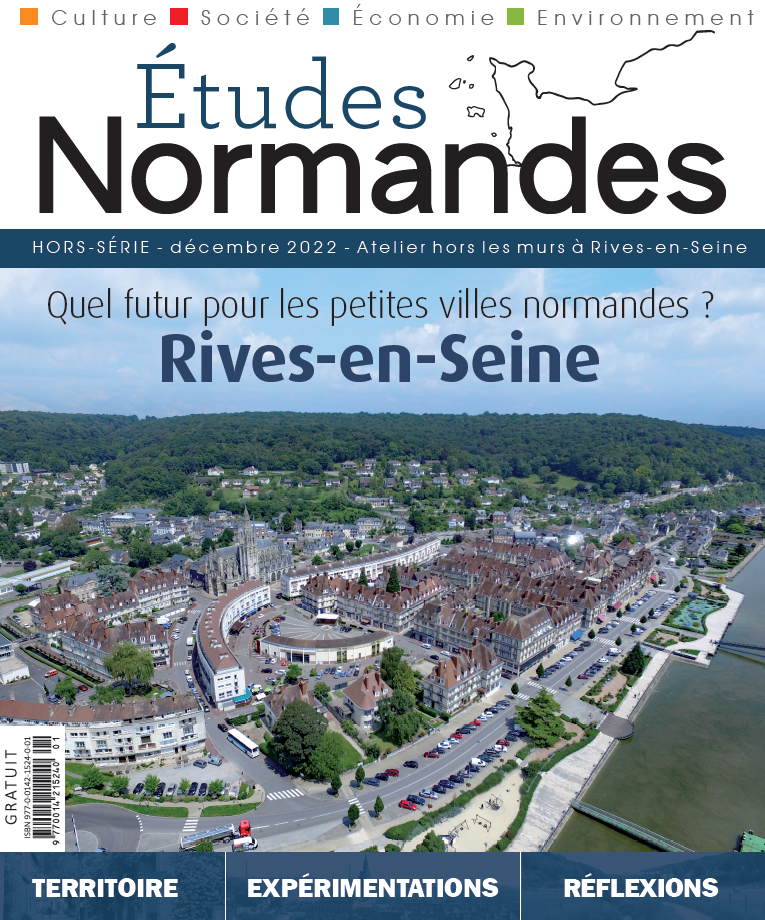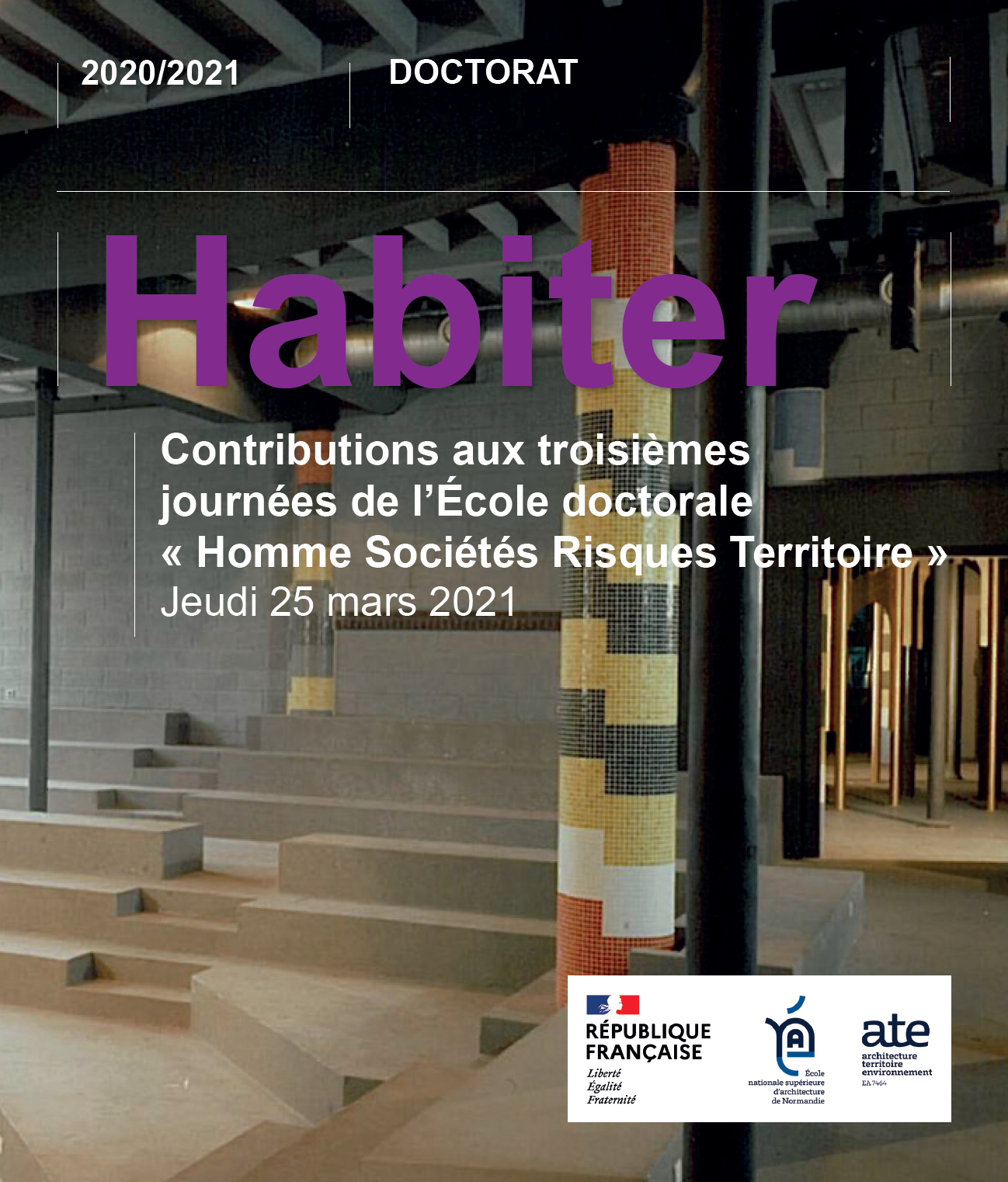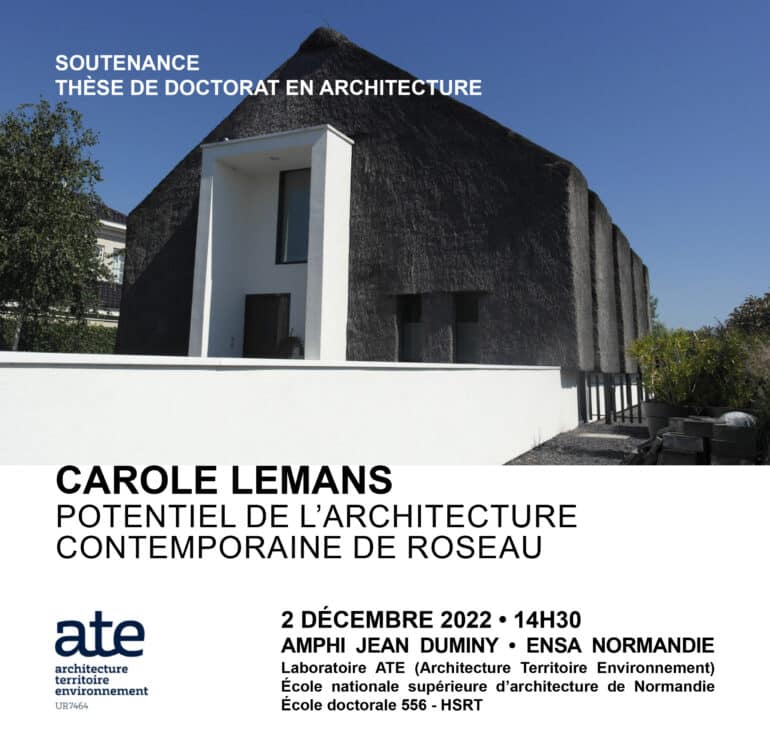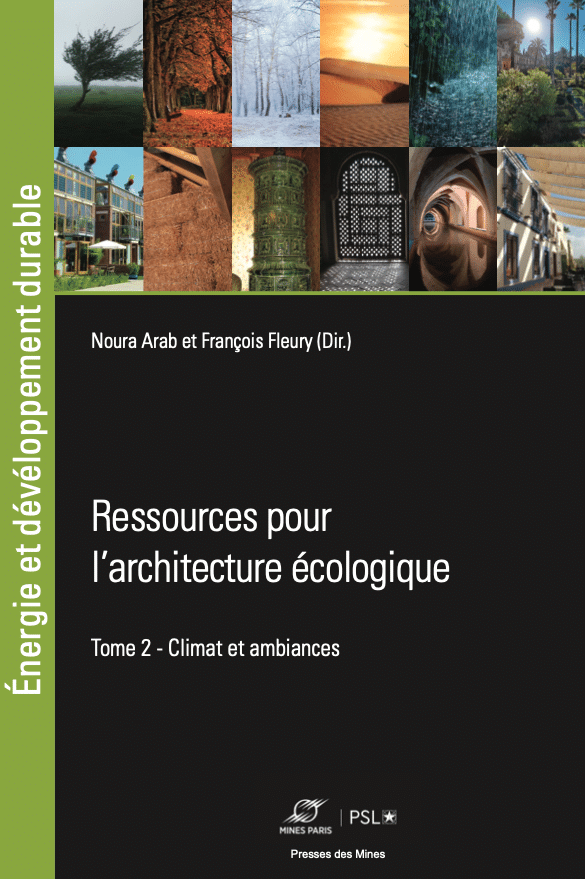
Les presses des Mines, l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie, le laboratoire ATE et la chaire Ressources Naturelles Renouvelables, Climat et Architecture, font paraître l’ouvrage Ressources pour l’architecture écologique. Tome 2, Climat et ambiances. Cet ouvrage collectif est issu du séminaire « Le climat , ressources ambiantales en architecture« , tenu en février 2023 à l’ENSA Normandie.
L’ouvrage est sous la direction de Noura Arab et François Fleury, enseignants-chercheurs au laboratoire ATE.
Résumé de l’ouvrage
Depuis ses débuts, l’architecture a toujours été influencée par le climat, s’installant là où il offrait un environnement favorable. Mais le climat n’est pas seulement une ressource pour l’architecture, il en est une des raisons d’être qui a longtemps façonné nombre de ses caractéristiques. Cependant, l’industrialisation a non seulement uniformisé les matériaux et les modes de construction, mais également les formes architecturales et le confort, ignorant les particularités climatiques locales. La consommation d’énergie fossile en a été largement augmentée, contribuant ainsi au réchauffement climatique auquel l’architecture doit aujourd’hui s’adapter. La climatisation se généralise, consomme encore de l’énergie et contribue à accroître l’îlot de chaleur urbain. Comment sortir de ce cercle vicieux ?
Il est temps de repenser l’architecture comme interface entre le climat et l’ambiance, en posant des questions cruciales face aux effets du changement climatique de plus en plus perceptibles. Ce deuxième tome sur l’architecture écologique explore les conséquences du changement de paradigme consistant à considérer le climat comme une ressource à valoriser et non plus comme un aléa dont il faut se protéger.
Il est crucial de replacer le contexte climatique au cœur de la conception architecturale et d’encourager des approches qui vont au-delà des normes environnementales standardisées pour garantir un mode de vie durable et respectueux de l’environnement.
Le lien vers le site de l’éditeur pour l’achat de l’ouvrage (version imprimée ou version numérique)
visuel : couverture de l’ouvrage Ressources pour l’architecture écologique. Tome 2, Climat et ambiances, presses des Mines, 2024